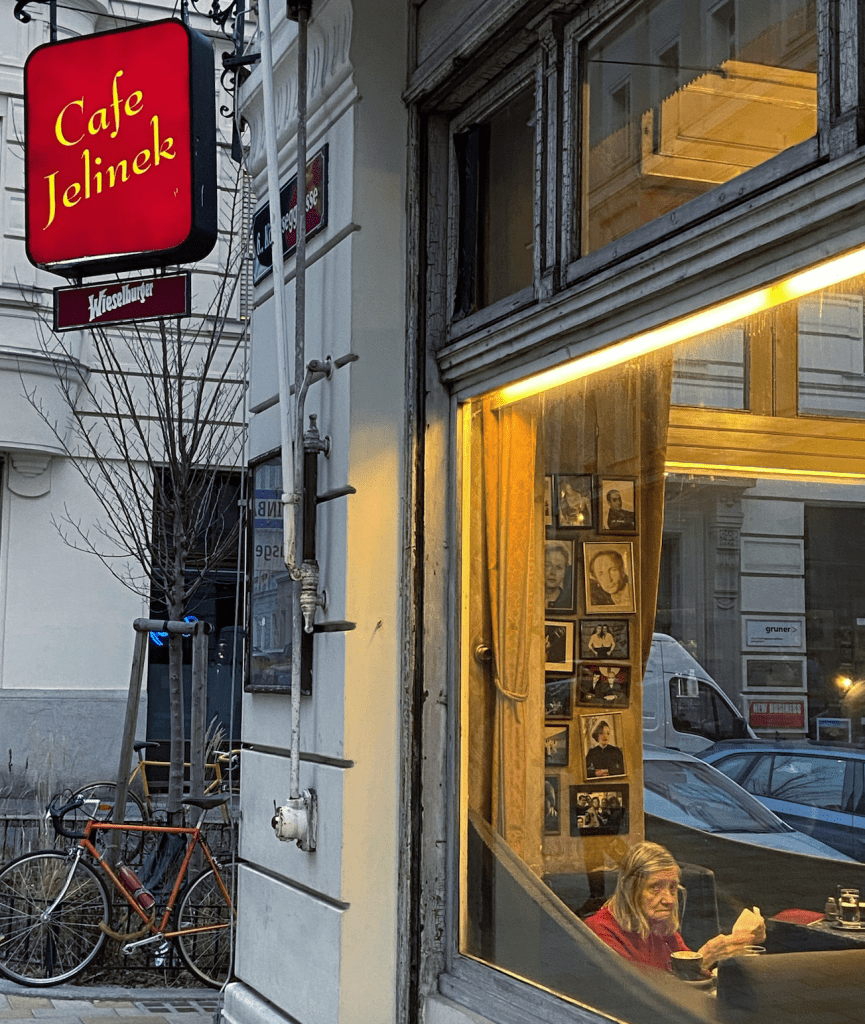— Pardon Madame, est-ce-que le 70 est déjà passé ? »
Je me suis invité à dîner chez H. ce soir. Encore une fois.
“Ne passe pas trop tard”, me demande-t-elle à chaque fois : elle se couche tôt, elle a besoin de beaucoup de sommeil. Pour la promesse d’un bon repas et d’un peu de compagnie, je me suis décidé à braver ma léthargie hivernale et le crachin glacial qu’un décembre déverse sans pitié sur Paris. Depuis mon retour, il y a quelques semaines, je me suis installé rue de Vaugirard, où je passe l’essentiel de mon temps, seul. Au premier étage, au fond d’une cour anonyme, dans l’immeuble le plus tristeconstruit à Paris après-guerre, l’appartement est sombre. Des ampoules au plafond n’égayent pas les murs beige-dépression ; les meubles sont rares : un lit de camp dans la chambre, une table et une unique chaise dans le séjour, la cuisine est vide, quelques cartons de déménagement font office de rangements. Tout y suinte l’ennui et la fin de l’envie.
Dans cette vie de désœuvrement, optimiser le temps ne sert à rien, bien au contraire. Je flâne aussi souvent que je le peux, je marche la tête au ciel, je prends toujours les chemins les plus longs ; perdre du temps devient une manière de le faire passer plus vite, loin de la rue de Vaugirard, si possible. Le métro serait plus rapide, pour ne pas arriver trop tard rue Vieille-du-Temple. Mais traverser Paris en bus, lentement, à la surface, permet de goûter les joies de la ville, spectlacle qui m’empêche avantageusement de me voir vivre. Et même si depuis le terminus, Place de l’Hôtel de Ville, le chemin pour arriver chez H., dans la glaciale humidité du soir, sera plus long, malgré la flemme, la paresse, l’à-quoi-bon, je m’oblige.
Le dernier 70 n’est pas encore passé. La vieille dame à qui j’ai posé la question confirme. Assise sur un banc à l’arrêt de bus devant l’Institut Pasteur, elle l’attend aussi, mais évidemment, bien sûr, il se fait désirer. Elle est partie au quart de tour : on ne peut pas se fier aux horaires affichés, ils sont rarement respectés, m’explique-t-elle sur un ton qui doit jamais devoir se résigner. Si je lui ai demandé, c’est parce qu’elle cache le tableau des horaires, que le crachin est devenu une averse en bonne et due forme, que le froid pénètre dans mes os et que nous partageons un abri de fortune, avec un espoir commun. Pour moi, c’est un hasard ; pour elle, en revanche, cela prend l’air d’une rencontre, d’un signe : en l’abordant moi, j’accepte de devenir son interlocuteur privilégié. Je préfère tenir un peu de distance et ne pas m’assoir sur le banc, à côté d’elle. Je m’adosse à la paroi de l’abri-bus, à l’abri de la pluie.
Elle enchaîne, sans reprendre son souffle de peur de perdre mon attention, ou le fil de sa pensée, elle explique qu’elle rentre chez elle, sur les quais qui font face à l’Île Saint-Louis. Sans réaction de ma part, elle continue. Oh, pas grand, l’appartement, un deux-pièces-cuisine, mais très confortable. Pensez donc, elle y vit depuis son mariage ! Ça avait été un peu étroit, avec son mari, et sa mère au début, et puis quand la petite était arrivée, mais bon la vie a suivi son cours. On y est arrivé, vous savez, Monsieur, on n’avait pas tellement le choix. Aujourd’hui, c’est presque trop grand pour elle toute seule.
Elle s’adresse à moi comme si nous étions de vieilles connaissances, un brin formelle, sans fausse intimité, mais avec une bienveillance que je ne peux m’empêcher d’apprécier. « Et oui, continue-t-elle, je sais ce que vous allez me dire, que c’est très bruyant, les quais. Ah ça, les voies sur berges, merci Pompidou, hein ! Mais la vue est un cadeau, chaque jour ! Et puis, nous ne sommes finalement pas si nombreux, nous, les Parisiens qui pouvons nous vanter d’habiter presqu’au-dessus de la Seine ! » Sa voix est rauque, éraillée, elle a dû beaucoup fumer. Elle parle sans marquer de pause, comme si elle craignait de perdre le fil de sa pensée.
La vieille est cintrée dans un imperméable en skaï, qui a l’air un peu léger pour la température hivernale. La tête haute, bien droite, elle porte une chapka en fourrure synthétique comme une couronne. Du sac à main qu’elle porte en bandoulière, plaqué contre son ventre, elle sort une fine Vogue blanche de son paquet, l’allume, et me montre un exemplaire du Parisien, plié. Elle espère terminer dans le bus les mots croisés, elle ne jette d’ailleurs jamais un journal si une grille n’est pas terminée, c’est un principe, eh oui, on a tous nos marottes. Je sors mon briquet, j’allume sa cigarette et j’en fume une aussi. Elle continue, concentrée, à proposd’une broderie qu’elle voudrait finir ces jours-ci, pour se débarrasser de ce truc-làqui prend la poussière… Mais manier l’aiguille lui casse les poignets. Finalement, elle ne pense pas qu’elle continuera.
Je réagis à peine, je n’encourage pas la conversation, je réponds à peine, par de brefs grognements. Je voudrais l’ignorer, je ne l’écoute que d’une oreille. Son regard cherche obstinément le mien, fuyant. Je fais mine de me concentrer sur ma clope.
J’ai faim, envie de rien, froid, je voulais juste savoir si je devais attendre le bus, ou me rabattre sur le métro. Et voilà qu’elle ne me lâche plus ; je n’ose rien dire, il pleut trop pour que je m’éloigne. Je voudrais l’ignorer, retourner à mes pensées, et ne pas plonger dans ses souvenirs à elle. J’ai mes soucis, moi aussi. Et si je le faisais, que dirait-elle ? Si elle apprenait que je me sens trop seul, trop jeune pour l’être, que je ne sais pas quoi faire de ma vie, que j’ai trop de temps, pas assez de travail ni d’ambition, que je veux voir le monde, mais que je ne sors pas de chez moi, que je végète, que j’en meure. Je pourrais déballer tout cela, m’insurger, hurler, mais comme toujours, je ne m’y résous pas. J’aimerais rester aimable, mais je ne peux pas l’écouter, si je ne peux pas m’aider moi-même. Je ne suis pas Mère Teresa. D’un coup de mon index, je lance mon mégot, qui atterit dans le caniveau.
Je lève les yeux au ciel, je soupire, peut-être trop fort.
— Non, mais dites donc, ça vous emmerde que je vous parle, on dirait ? » Elle me regarde, vexée, indignée, une main sur sa canne, dans l’autre sa cigarette. Si on ne peut plus discuter, on fait quoi, on crève chacun dans son coin, comme des clébards, hein ? » Je bredouille une excuse, vous avez raison, je suis désolé. Rassurée, elle poursuit son discours. Elle ne regardera pas la télé, il ne diffuse que des conneries qui ennuient, mais pas assez pour bien dormir. Il y aurait bien son feuilleton, mais on est mercredi et il ne passe que le vendredi. « Est-ce que vous le suivez, vous aussi, Monsieur ? » Non, je n’ai pas la télévision. Si au moins je l’avais, je pourrais sauvagement tuer le temps, en la regardant jour et nuit, comme une punition que l’on s’inflige. En pensant à ce retour raté à Paris, mon esprit vagabonde et s’égare. Comme toujours, tout s’emballe et se mélange lorsque que je passe ma vie en revue : la peur de vivre, le sentiment d’imposture, les ambitions revues à la baisse, les mauvais choix, les journées inoccupées, interminables, passées dans mon trou sans joie.
La vieille se met à tousser, jette sa cigarette par terre, le mégot marqué de son rouge à lèvres. Je croise sonregard ; en me fixant toujours, elle fait un geste vers le siège à côté d’elle. « Allez, venez vous assoir ». J’obéis. Je voudrais pleurer, parler, l’isolement, l’hébétude de l’inactivité, mes rêves auxquels je ne crois qu’a moitie, les cigarettes que j’enchaîne et que j’éteins dans des pots de yaourts, l’alcool qui m’engourdit et m’anesthésie, les nuits sans sommeil. Et la tête, qui me fait mal quand je n’ai plus de larmes, quand je me persécute pour trouver le moment exact où, sans m’en rendre compte, j’ai l’impression d’avoir perdu le contrôle de ma vie.
Rien ne l’arrête, de grâce, par pitié, Madame, s’il vous plaît ! Elle parle de son dîner maintenant, elle mangera trop tard, elle ne sait même pas ce qu’il reste au frigo, et puis de toute façon, elle n’a plus beaucoup d’appétit, surtout le soir, surtout depuis que…
Elle s’interrompt, baisse la tête. Quelques secondes de silence.
— Quelle connerie, la solitude ! reprend-elle dans un soupir.
Comme une explosion, les mots résonnent dans le vide silencieux qui m’habite.
Ce soir, j’arriverai encore trop tard chez H. Elle ne m’aura pas attendu pour dîner, mais elle mettra mon assiette au micro-ondes dès qu’elle entendra sonner. Elle s’assiéra à table en face de moi, avec sa tisane, nous bavarderons, de tout et de rien, comme toujours. Nous attendrons que P. rentre du travail – rarement avant 22 heures, ces jours-ci, puis elle ira se coucher. Je boirai avec lui un peu de whisky, pour lui faire plaisir, nous discuterons, et je prendrai congé, pas trop tard.
Puis le rituel nocturne, presqu’immuable, commencera.
Je trainerai dans le quartier, de bar en bar, sans conviction, je boirai trop de bière, en espérant que malgré le froid et avant que ne parte le dernier métro, quelqu’un me trouve et m’emmène chez lui. À son bras, je me prendrai alors à croire que j’existe aux yeux du monde, sinon aux miens.
Si j’y réussis, alors tôt le lendemain matin, je rentrerai dans l’appartement vide du premier étage, du bâtiment du fond de la cour, de l’immeuble sinistre, de la rue de Vaugirard. Une nouvelle journée commencera, l’illusion de la nuit m’aura temporairement redonné des forces, un brin de confiance pour tenter de retrouver un sens à ma vie, ou au moins à ma journée. Et un frêle espoir naîtra, parce que, pendant quelques heures cette nuit, avec les modestes moyens du bord, j’aurai encore réussi à tromper cette pute de solitude.
Ma vieille semble contrariée, je sens qu’elle aimerait que je parle, que je lui donne raison, que je lui montre que oui, elle existe elle aussi, qu’elle n’est pas encore un fantôme. Parce que certainement qu’elle aussi, elle doit crever que personne ne lui réponde, que toutes ses conversations ne soient que des dialogues à sens unique, dans les transports en commun ou dans la queue aux caisses d’un supermarché. Mais je ne me sens pas le courage : écouter ou aider les gens est au-delà de mes capacités actuelles.
Cela doit se lire sur mon visage.
— Monsieur ? Ça va ? » Sa main effleure mon bras, avec douceur. Sans rien dire, je fais signe que oui. Malgré tout. Rien n’est facile, mais encore une fois, tout ira forcément bien. Les larmes montent aux yeux, elles hésitent, mais ne sortent pas. Je la regarde et lui souris, autant que je peux, résigné. Elle ne cache pas son soulagement.
Deux 39 se succèdent à bref intervalle, suivis par un 89. Toujours pas de 70 ; y en aura-t-il encore un ce soir ? J’ai les pieds mouillés, je suis transi, j’ai oublié de prendre mes gants. Je suis engourdi, la tête lourde.
Elle est convaincue que nous avons raté le 70. « On ne peux jamais savoir, si le dernier est déjà passé ou pas ! Et on se retrouve toujours comme des abrutis à attendre par un temps pareil ce con de bus qui passera plus. »
À quel moment faut-il renoncer, demande-t-elle. C’est à moi que vous posez cette question, Madame ?
— Ah putain non, alors là, si je l’ai raté… Ils nous font chier, la RATP ! Me taper le métro maintenant, de Volontaires à Saint-Paul, avec le couloir à Concorde qui n’en finit pas, non merci, aucune envie ». J’ai parlé. Je crois qu’elle n’attendait que ça, entendre ma voix. Elle est interloquée, l’espace d’un instant, elle me dévisage encore, mais comme si, alors qu’enfin qu’elle connait le son de ma voix, elle accédait à de nouvelles informations qui la renseignaient enfin sur ma personne.
— Oh, s’il faut changer à Concorde, eh bien, changez à Concorde. Il y a quand même pire que ça dans la vie, non ? Allez, vous êtes trop jeune pour vous plaindre ! » Elle me sourit, avec une certaine connivence. Sur ses dents de fumeuses, une marque de rouge à lèvres.
Juste avant que ne meure l’espoir, le 70 se profile au loin, dans la rue de Vaugirard déserte. En s’approchant, la clochette tinte. Je laisse monter la vieille en premier, elle agrippe la barre à l’entrée du bus, et se hisse à l’intérieur. Je me tiens derrière elle, comme pour m’assurer qu’elle ne tombe pas, qu’elle ne glisse pas, qu’elle ne se fracture pas le fémur. J’aimerais qu’elle se sente protégée, par quelqu’un qui se préoccupe de ses os fragiles, qui soit là pour la rattraper au moindre faux pas.
Elle trottine vers le fond du bus, marquant la cadence de sa canne ; je m’assieds à côté d’elle.
— Le 70 à cette heure-ci, c’est un peu la roulette russe, explique-t-elle satisfaite en guise de conclusion, on ne sait jamais s’il est déjà passé ou pas, leurs horaires sont tellement approximatifs. Mais au moins là, quand il arrive, on est sûr de pouvoir s’asseoir ! »
Pendant quelques minutes, dans la douce chaleur, dans le bercement des vibrations du bus, un silence partagé s’installe, qui n’appartient normalement qu’aux vieux amis. Le bus marque plusieurs arrêts le long de la rue de Sèvres, avant de longer le Bon Marché. Je suis son regard, elle scrute les façades du grand magasin. Dans la succession des vitrines illuminées, lutins, poupées et nounours automates emballent gaiement des cadeaux dans un décor féérique de maison de rêves décorée pour Noël, ou descendent des collines en luge, dans un tourbillon de flocons de neige cotonneux.
Dehors, il semble avoir arrêté de pleuvoir.
Paris (Décembre 2005 – Octobre 2024)